Introduction : quand la culpabilité s’installe après le choc
“Pourquoi je n’ai pas réagi ? Pourquoi moi ?” — ces phrases résonnent souvent chez les personnes ayant vécu un traumatisme.
La culpabilité fait partie des réactions psychiques les plus fréquentes après un choc émotionnel : accident, agression, catastrophe, perte, ou encore violence psychologique.
Pourtant, cette culpabilité n’est pas une preuve de responsabilité. Elle est le signe d’un esprit en souffrance, cherchant désespérément à donner du sens à l’inacceptable.
Cet article explore les mécanismes psychiques de la culpabilité, les différentes formes qu’elle peut prendre, et les pistes thérapeutiques pour s’en libérer durablement.
Comprendre la culpabilité après un traumatisme
Après un traumatisme, il est fréquent que l’esprit rejoue sans cesse le scénario : « Et si j’avais fait autrement ? »
Ces ruminations alimentent la culpabilité et donnent l’illusion qu’on aurait pu éviter le drame.
L’anxiété post-traumatique favorise ce mécanisme : le cerveau tente de reprendre le contrôle en imaginant d’autres issues possibles à l’événement.
Ces pensées répétitives – « j’ai eu de la chance », « j’ai la poisse », « j’aurais dû réagir plus vite » – entretiennent un sentiment de responsabilité illusoire.
Elles enferment la personne dans le passé, l’empêchant de reconnaître que l’événement était hors de son contrôle.
Les différentes formes de culpabilité
Un traumatisme peut déclencher plusieurs types de culpabilité :
- La culpabilité de survie : les individus se sentent illégitime d’avoir survécu quand d’autres ont souffert ou perdu la vie.
- La culpabilité d’impuissance : se reprocher de ne pas avoir réagi autrement ou s’être défendu. Chez les individus dissociés, cette culpabilité est fréquente.
Si vous souhaitez en apprendre plus sur la dissociation traumatique et comment la gérer, je vous laisse découvrir mon article : « 4 astuces pour gérer la dissociation traumatique. »

Culpabilité et traumatisme
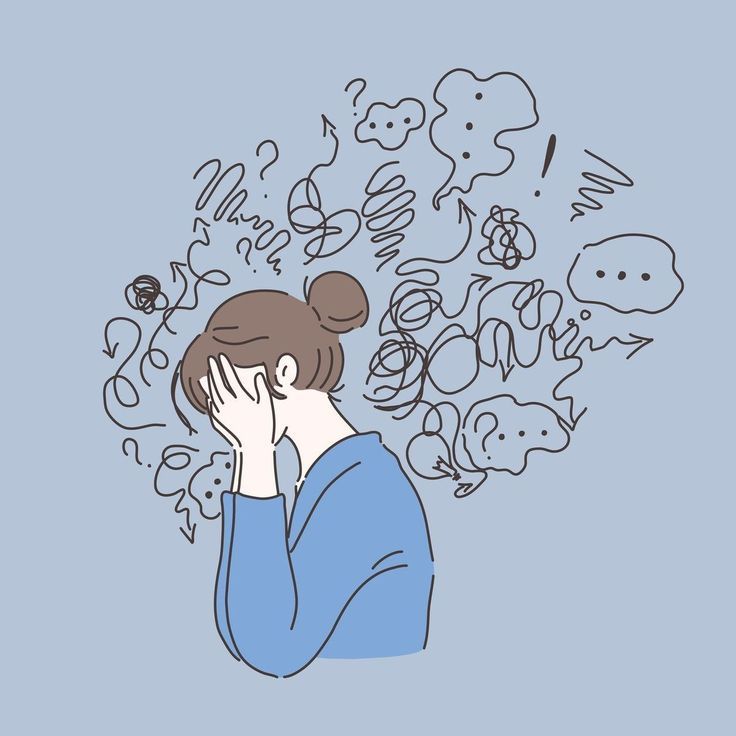
Les ruminations, la honte, la culpbilité et les pensées négatives se renforcent mutuellement : plus l’individu s’accuse, plus il s’éloigne de la réalité objective de l’événement.
Ces pensées automatiques négatives – « c’est de ma faute », « je l’ai bien mérité », « j’aurais pu éviter ça » – bloquent le processus de guérison.
Elles maintiennent la personne dans une réalité intérieure où le traumatisme continu d’exister, même longtemps après les faits.
Se libérer de la culpabilité
Le travail thérapeutique consiste à déconstruire la culpabilité :
- Identifier les pensées automatiques et les croyances érronées;
- Identifier les pensées négatives;
- Développer des pensées alternatives plus positives et réalistes;
- Travailler sur l’autocompassion;
- S’engager dans un accompagnement thérapeutique par thérapie cognitive et comportementale pour restructurer les pensées, par thérapie des schémas pour identifier les schémas problématiques et par EMDR pour retraiter le souvenir traumatique.
Conclusion
La culpabilité qui suit un traumatisme n’est pas une faute morale. Elle exprime la couffrance, la confusion et le besoin de sens.
La thérapie aide à redonner à la victime sa juste place : celle d’une personne qui a survécu, non d’une personne coupable.
La culpabilité ne prouve pas la responsabilité. Elle exprime la douleur d’un esprit qui chercher à accepter l’inacceptable.
Pour aller plus loin : découvrez d’autres articles dédiés à la compréhension du psychotraumatisme, des troubles anxieux et des ressources pour apaiser la souffrance psychique.

Rétroliens/Pings